(Colloque Utopsie)

Je voudrais vous parler, brièvement, de l’amitié dans les institutions psychiatriques. En particulier de l’amitié entre soignant et soigné. Evidemment, ça semble au premier abord loin des problèmes qui s’imposent à nous aujourd’hui, la repression, la regression sécuritaire. Mais l’amitié, c’est aussi une façon d’y résister. En ce qui me concerne, je l’ai rencontrée comme patient dans des lieux de soin où se pratique la psychothérapie institutionnelle. Ca ne veut pas dire qu’elle n’existe que là, mais il y a certaines raisons qui font qu’une amitié peut se nouer plus facilement entre un soignant et un soigné dans ce genre d’institution.Je vais vous raconter comment ça s’est passé. A La Borde dans les années 70, et dans un foyer de post-cure parisien, le foyer Capitant dans les années 90, j’ai rencontré un ou plusieurs soignants dont je suis devenu l’ami, et avec qui j’ai gardé des relations amicales, jusqu’à ce jour. A La Borde, c’est à l’occasion d’un travail mené par des gens du CERFI, un collectif de chercheurs rassemblés autour de Félix Guattari, que je me suis lié d’amitié avec des moniteurs qui travaillaient au bureau économique. Mais à La Borde, travailler ici ou là, au bureau économique ou à la cuisine, ou à la ferme, ou à la buanderie, c’est participer pleinement aux soins. Toujours est-il que j’ai proposé, ou qu’on m’a demandé, je ne sais plus, d’illustrer le livre qu’ils écrivaient sur La Borde, qui a été publié trois ans plus tard, en 1976. Ca s’appelle : Histoires de La Borde. C’est donc autour d’un travail que ce sont nouées ces amitiés, et surtout l’une d’entre elles, avec un moniteur qui faisait directement partie du collectif qui écrivait cette histoire de La Borde, un jeune philosophe qui est devenu plus tard metteur en scène d’opéra, et directeur d’un théâtre.Cette amitié s’est précisée le jour où j’ai été invité à diner, un soir, avec ces moniteurs et avec d’autres, dans leur maison de campagne à quelques kilomètres de la clinique. Ils voulaient que je parle de ces illustrations. Ils m’ont donc offert l’hospitalité, le temps d’une soirée, même si je n’ai pas dormi sur place, parce que mon statut de pensionnaire m’obligeait, sécurité sociale et assurances aidant, à dormir à La Borde. A partir de là je les ai beaucoup fréquenté, surtout à Paris. J’ai fréquenté le siège du CERFI jusqu’en 1981, pour les voir, pour y écrire, pour y dessiner, également pour y manger. A l’époque j’étais sans le sou, et presque sans toit. J’ai retrouvé ces amis vingt ans plus tard, quand les choses sont allées mieux pour moi. C’était important pour moi cette hospitalité en marge de l’institution hospitalière. Ca me donnait du recul par rapport à la clinique, de la distance par rapport aux soins, un point de vue extérieur. C’était pour moi un espace démédicalisé, mais pas sans lien avec la psychiatrie et ses institutions. Ce que j’en ai fait dans l’immédiat, c’est une autre histoire. En vérité ça m’a amené à fuir La Borde, à ne plus m’y faire soigner. Mais ça ne tient pas tant à mes amis du CERFI eux-mêmes, qu’à une série de contre-sens, qu’à une conduite de rupture, de fuite et d’échec. En tout cas ce que j’ai vécu au CERFI me permet aujourd’hui de comprendre certains problèmes institutionnels, me permet aussi d’entretenir plus ou moins étroitement ces amitiés.La même chose s’est produite au foyer Capitant. Parce que je voulais préparer une agrégation d’arts plastiques, un infirmier, que j’aimais bien, m’a invité à déjeuner chez lui, avec un de ses enfants et avec sa femme, qui est professeur d’arts plastiques dans un collège. Elle m’a parlé de son travail, m’a invité à un de ses cours. A l’époque, je ne dormais plus au foyer, mais j’y venais deux trois fois par semaine pour y rencontrer un médecin et une psychologue, pour y diner aussi, histoire de faire la transition entre un domicile personnel et le foyer. Cet infirmier avait été mon référent pendant mon séjour, et nous nous entendions très bien. Après cette invitation, nous sommes devenus peu à peu des amis. Nous nous voyons aujourd’hui très souvent, et nous continuons d’avoir de longues conversations sur la folie, sur ses institutions.
L’amitié, est-ce que ça marche ? Dans les années 70, les gens que je voyais, que j’aimais bien, étaient tous un peu fous, et révolutionnaire chacun à sa façon. Il y a eu beaucoup de bleus à l’âme, et mes amitiés de l’époque n’ont pas permis que ça aille mieux pour moi, c’est le moins qu’on puisse dire. Mais dans les années 90, nous nous étions tous posés quelque part, d’une façon ou d’une autre, même si nous n’avions pas renoncé à nos idées, à nos engagements, et cette amitié avec cet infirmier a été essentielle dans mon retour à la raison. Je dois dire que mes copains du CERFI n’étaient pas des professionnels de la santé mentale. La psychiatrie n’était pas leur métier, ils ne pouvaient pas vraiment remédier à ma folie, sinon en me disant d’aller me faire soigner à La Borde, ce que je ne voulais plus ; alors que mon copain de Capitant, infirmier psychiatrique, sait des tas de choses sur la folie et sur la raison, sur les médicaments et sur les médecins, sur les hôpitaux et sur les traitements, qui m’ont été fort utiles dans les moments difficiles. Et puis dans les années 90, je n’avais plus vraiment le choix ; je ne pouvais plus m’offrir d’errer sans cesse, il fallait que j’aménage ma folie, que je la rende vivable, et avec une AAH j’en avais enfin les moyens économiques.Mais il ne s’agit pas seulement de savoir si l’amitié donne de bons résultats. Il y a des lieux où l’on veut éviter à tout prix les conflits, quels qu’ils soient. De la même façon, il y a des lieux où l’on veut éviter à tout prix l’amitié entre soignant et soigné, et j’ajouterai, éviter l’amitié même entre soignés. Le devenir d’une amitié, si elle va se montrer bénéfique ou pas, personne ne peut le dire, qu’on soit fou ou pas. Mais exclure l’amitié, à priori, pour les fous comme pour ceux qui ne le sont pas, c’est absurde.
Qu’est-ce que je veux dire par amitié ? Essentiellement offrir l’hospitalité. On invite ses amis chez soi, à manger, à dormir, ou les deux. Je ne dirai pas que c’est toujours comme ça, mais ça y ressemble. Ces gens, dont je suis devenu l’ami, m’ont invité chez eux, ensuite je les ai invité chez moi, quand j’ai eu un chez moi. Ca ne m’est jamais arrivé dans les lieux de soin que j’ai connus où se pratique une psychiatrie traditionnelle. J’ai pu y apprendre, y travailler, mais je n’y ai jamais rencontré d’amis parmi les soignants. Ni vraiment parmi les soignés, même si je me sentais proche de certains d’entre eux. Je ne pense pas que ce soit seulement une affaire d’atomes crochus. J’ai fréquenté un atelier thérapeutique à Paris, à la fin des années 80 et au début des années 90, où j’ai beaucoup dessiné, peint, écrit, et filmé. Il y avait un éducateur, quelqu’un de bien. Nous avions des tas d’activités et d’intérêts en commun. Nous allions dans la même université, lui pour devenir psychologue, moi pour y étudier les lettres modernes. Il m’a aidé à faire ma première exposition, il est venu ensuite à certains de mes vernissages, mais jamais il ne m’a invité chez lui. Nous avions de l’estime l’un pour l’autre, mais nous n’étions pas amis. Ses théories, ou sa déontologie, ou je ne sais quoi, s’y opposait. Nous communiquions, nous échangions, mais nous ne partagions pas. Car dans cet atelier thérapeutique, il me semble que la distance habituelle et comme naturelle entre un médecin et son patient était généralisée à toute l’équipe soignante, de l’ergothérapeute à la cuisinière, de l’éducateur à l’infirmière, du psychologue à la secrétaire. Du métier, du respect, de l’estime éventuellement, mais pas d’amitié.Avec mes amis du CERFI je partageais, avec mon ami infirmier je partage. En ce qui le concerne, il s’en est expliqué à propos du délire. Il ne s’agit pas tant, dit-il, de raisonner sur le délire, quand on est infirmier, vivant avec les fous au quotidien. Il ne s’agit pas d’expliquer à un fou son délire par du papa ou de la maman, ou par tout autre cause raisonnante qui risque finalement de l’aggraver, mais de le partager, de faire sentir à celui qui délire, que son délire ne vous est pas étranger. En partageant le délire de cette façon, on l’apaise. Ce n’est pas le conforter, ou y céder, c’est faire entendre à celui qui délire que la raison ne lui est pas étrangère. Et partager comme ça ne s’apprend pas dans les livres, ça vient du sentiment pour un soignant que la folie ne lui est pas étrangère. Or vraiment, il n’y a que dans les lieux de soin où se pratique la psychothérapie institutionnelle que j’ai rencontré une ambiance où les soignants étaient sérieusement invités à ne pas regarder mon délire comme un machin qui leur était totalement étranger, totalement extérieur, avec lequel ils n’avaient rien de commun, pur objet d’étude et d’interprétation, pur objet de connaissance. Que certains, même dans les endroits ouverts de la psychothérapie institutionnelle, ne répondent pas à cette invitation, c’est sûr, mais dans l’ensemble on voulait bien ne pas élever trop haut un mur entre eux et moi. Or c’est sur la base du partage qu’une amitié devient possible, et en ce qui me concerne qu’une forme de guérison, d’aménagement de ma folie, est devenue possible.
 D’ailleurs la psychothérapie institutionnelle ne considère pas qu’il y a d’un coté les soignants, de l’autre les soignés. Elle considère qu’un soigné peut faire fonction de soignant, le plus souvent à l’égard d’autres soignés, par la parole, par les activités, par les gestes de la vie quotidienne, mais aussi, théoriquement, à l’égard d’un soignant. Quand on est fou, et soigné comme tel, on a l’impression de temps en temps qu’on fait plus de bien aux soignants qu’ils ne vous en font. On a même parfois l’impression que certains ne vous soignent que pour se guérir de leur folie. A La Borde comme à Capitant, la limite entre soignant et soigné pouvant s’amenuiser jusqu’à presque disparaître ici ou là, une amitié hors l’institution devient possible, une hospitalité, non hospitalière, devient possible entre soignant et soigné, et bien évidemment entre soignés. Il faut dire que certaines autorités La Bordiennes ne voyaient pas d’un très bon œil mes amitiés. Elles pensaient sans doute que ça représentait un danger pour moi. Dans l’immédiat, et surtout à moyen terme, elles avaient raison, mais au bout du compte elles ont eu tort. Et puis, n’est-ce pas, on ne va pas toujours éviter, ou empêcher, ou interdire le vin et les amis, à moins de tenir sur la folie le discours de Nicolas Sarkozy et compagnie. Je le dis d’autant plus volontiers que je ne bois du vin qu’avec mes amis.Je veux quand même préciser qu’il ne s’agit pas d’être copain à tout prix, ou d’inviter n’importe qui chez soi, histoire de se faire plaisir, ni que la psychothérapie institutionnelle se réduit à la possibilité d’une amitié. Ce n’est qu’un aspect parmi beaucoup d’autres dispositifs, que ceux qui inventent la psychothérapie institutionnelle, et qui l’inventent avec les patients, vous expliqueraient mieux que moi. Car je n’envisage tous ces problèmes que du point de vue d’un ancien patient qui continue de s’intéresser à la folie et à ses institutions. Il y a nécessairement beaucoup de choses qui m’échappent. J’ai envie de dire qu’il en va de même du point de vue des soignants : il y a nécessairement beaucoup de choses qui leur échappent, même s’ils essayent de se mettre à la place des soignés. Mais les places de soignant et de soignés ne sont pas échangeables. Elles sont parfois partageables, à mon avis sur la base de l’amitié. Ca implique la dimension de l’hospitalité, ou du moins, si l’on ne sort pas du cadre de l’institution, la dimension de l’accueil.
D’ailleurs la psychothérapie institutionnelle ne considère pas qu’il y a d’un coté les soignants, de l’autre les soignés. Elle considère qu’un soigné peut faire fonction de soignant, le plus souvent à l’égard d’autres soignés, par la parole, par les activités, par les gestes de la vie quotidienne, mais aussi, théoriquement, à l’égard d’un soignant. Quand on est fou, et soigné comme tel, on a l’impression de temps en temps qu’on fait plus de bien aux soignants qu’ils ne vous en font. On a même parfois l’impression que certains ne vous soignent que pour se guérir de leur folie. A La Borde comme à Capitant, la limite entre soignant et soigné pouvant s’amenuiser jusqu’à presque disparaître ici ou là, une amitié hors l’institution devient possible, une hospitalité, non hospitalière, devient possible entre soignant et soigné, et bien évidemment entre soignés. Il faut dire que certaines autorités La Bordiennes ne voyaient pas d’un très bon œil mes amitiés. Elles pensaient sans doute que ça représentait un danger pour moi. Dans l’immédiat, et surtout à moyen terme, elles avaient raison, mais au bout du compte elles ont eu tort. Et puis, n’est-ce pas, on ne va pas toujours éviter, ou empêcher, ou interdire le vin et les amis, à moins de tenir sur la folie le discours de Nicolas Sarkozy et compagnie. Je le dis d’autant plus volontiers que je ne bois du vin qu’avec mes amis.Je veux quand même préciser qu’il ne s’agit pas d’être copain à tout prix, ou d’inviter n’importe qui chez soi, histoire de se faire plaisir, ni que la psychothérapie institutionnelle se réduit à la possibilité d’une amitié. Ce n’est qu’un aspect parmi beaucoup d’autres dispositifs, que ceux qui inventent la psychothérapie institutionnelle, et qui l’inventent avec les patients, vous expliqueraient mieux que moi. Car je n’envisage tous ces problèmes que du point de vue d’un ancien patient qui continue de s’intéresser à la folie et à ses institutions. Il y a nécessairement beaucoup de choses qui m’échappent. J’ai envie de dire qu’il en va de même du point de vue des soignants : il y a nécessairement beaucoup de choses qui leur échappent, même s’ils essayent de se mettre à la place des soignés. Mais les places de soignant et de soignés ne sont pas échangeables. Elles sont parfois partageables, à mon avis sur la base de l’amitié. Ca implique la dimension de l’hospitalité, ou du moins, si l’on ne sort pas du cadre de l’institution, la dimension de l’accueil.
Ces amitiés se sont nouées spontanément, je le répète, autour d’un travail, d’une activité, d’un intérêt commun, avec des atomes très crochus. Pas sur la base d’une simple curiosité. Considérée dans sa dimension thérapeutique, comme toute relation thérapeutique elle ne va pas sans difficultés, sans des hauts et des bas, sans des affects et sans des risques. Sans échouer ou réussir. Cependant je remercie ma psychiatre d’avoir toujours évité les relations sociales entre nous, gardant intacte sa neutralité, ses distances, malgré mon désir de mettre parfois notre relation en danger, comme j’ai pu le lui dire. Je comprends qu’il ne puisse pas y avoir d’amitié entre nous. Il y a des raisons théoriques, professionnelles, personnelles, pour qu’il en soit ainsi. Toutefois il y a entre nous un peu plus que de l’estime, c’est à dire que je ne la considère pas seulement comme un bon médecin. Je crois que ça tient pour beaucoup à ce qu’elle me reçoit à son cabinet en ville, car les maisons ressemblent à ceux qui les habitent, alors qu’un dispensaire est un lieu parfaitement anonyme. Pas une amitié donc, parce que je ne vis rien, je n’ai rien à vivre au quotidien avec elle, mais quelque chose de l’hospitalité. Il n’en va pas de même avec les membres d’une équipe soignante. Autant on peut accepter de n’avoir avec un médecin que des relations de soin, autant il est frustrant de penser que l’on n’aura jamais de relation amicale avec quelqu’un d’une équipe soignante, quelqu’un qu’on voit au quotidien, dans beaucoup de circonstances de la vie quotidienne, pour la seule raison qu’il fait partie de l’équipe soignante. A La Borde, où les médecins vivent des relations au quotidien avec les pensionnaires, j’ai pu venir dans la maison du médecin qui s’occupait de moi. Est-ce un bien ou un mal, à mon avis ce n’est pas seulement le nœud du problème. Voilà je l’espère, matière à réflexion pour résister à la folie sécuritaire.




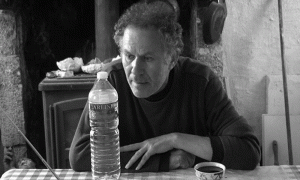 Fichier du 4 janvier 2010 (Bonus – à propos d’Anna Caméra)
Fichier du 4 janvier 2010 (Bonus – à propos d’Anna Caméra) FICHIER DU 10 MAI 2009
FICHIER DU 10 MAI 2009